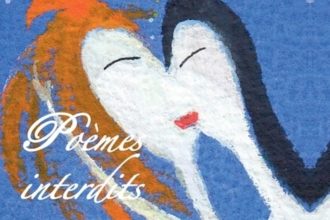Jean de La Fontaine ou l’art délicat de faire jouir en vers
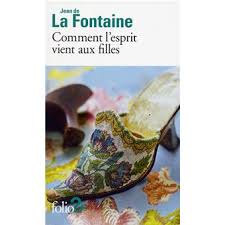
« L’amour fait plus d’esprit que le vin. » Jean de La Fontaine, Les Amours de Psyché et Cupidon
On connaît Jean de La Fontaine pour ses fables, son corbeau, son renard et ses morales bien léchées enseignées dès l’école primaire. Mais on oublie souvent qu’il fut aussi l’un des plus grands libertins lettrés du Grand Siècle. Et bien avant de faire parler les animaux, il fit longuement parler les corps. Dans Comment l’esprit vient aux filles et autres contes libertins, recueil qui rassemble une partie de ses contes érotiques publiés entre 1665 et 1674, on découvre un autre La Fontaine, plus proche du boudoir que de la basse-cour. C’est un auteur malicieux, cru sans jamais être sale, délicat dans l’art de l’insinuation, joyeusement obscène et furieusement moderne. Ici, point de morale édifiante, mais des récits ciselés comme des bijoux coquins, où l’intelligence flirte avec l’érotisme, où le plaisir est un prétexte à la finesse et où le sexe devient un art de vivre autant qu’un art d’écrire. L’auteur ne parle pas aux enfants, mais aux courtisanes, aux esprits libres, aux lecteurs qui savent que la langue, au sens large, est une affaire de souffle, de rythme et de glissements voluptueux. Rappeler ce versant nocturne et savoureux de l’auteur n’est pas le trahir. C’est le révéler dans sa totalité et redonner à sa plume toute son amplitude : celle d’un écrivain qui savait aussi bien faire parler les animaux que gémir les corps. Et lire ces contes aujourd’hui, c’est éprouver une forme de jubilation et de liberté. Chronique d’une irrévérence d’autant plus précieuse qu’elle est ciselée dans une langue exquise.
Du libertinage en vers
À l’époque de Louis XIV, le conte en vers galant et grivois est un genre à la mode. Dans les salons, on rit, on lit, on jouit des mots et de l’esprit. Dans cette atmosphère où l’érotisme se déclame et se dissimule dans l’alexandrin, La Fontaine excelle. Il compose des petits récits licencieux où l’amour se fait avec une grâce mordante, où le clergé est ridiculisé, et où les femmes prennent souvent le pouvoir sur les hommes… ou sur leurs désirs.
« Si les filles avaient du vin dans la tête, Elles feraient toujours des folies en fête. » Comment l’esprit vient aux filles
Ici, point de sermons, tout est sourire, sous-entendu et suggestion. La rime s’ouvre comme un corsage, dévoilant peu à peu une vision du sexe libre, joyeuse et volontiers moqueuse des conventions sociales. La Fontaine écrit pour amuser, mais il instruit aussi, d’un art de vivre qui mêle lit et esprit, luxure et lucidité.
Un conte, un programme et un manifeste
Dans le conte qui donne son titre au recueil, La Fontaine imagine une sorte de traité poético-scientifique sur l’origine de l’intelligence féminine. Le postulat est simple : l’esprit vient aux filles par l’amour, par la chair et par la pratique. Autrement dit, ce n’est pas en lisant, mais en jouissant qu’elles s’éveillent.
« On dit que l’esprit vient aux filles,
Mais sait-on jamais d’où il vient ?
La réponse est dans leurs chevilles,
Ou plutôt dans ce qu’on y tient. »
C’est grivois, certes. Mais c’est surtout radicalement subversif. Dans un siècle où l’on doute encore que les femmes aient un esprit tout court, La Fontaine répond qu’elles en ont et qu’il est directement connecté à leur plaisir. Le conte, derrière sa gaudriole, est un plaidoyer pour le corps comme source de savoir. Une philosophie sensuelle, presque féministe.
Les femmes, stratèges du plaisir
Si les contes de La Fontaine sont remplis de maris trompés, de curés dupés, de vierges émoustillées, les femmes n’y sont jamais passives. Bien au contraire. Elles rient, elles conspirent, elles feignent l’innocence pour mieux glisser la main sous la soutane du confesseur.
Prenons Le Faucon, l’un des plus délicieux récits du recueil : une jeune épouse s’arrange pour que son mari, jaloux et possessif, l’enferme dans une tour… ce qui ne l’empêche en rien de recevoir un amant. La Fontaine n’en fait pas une tragédie, mais une farce sensuelle où l’intelligence féminine fait sauter les cadenas de la vertu.
« Elle avait l’esprit plus fin que sa taille,
Et sa taille déjà faisait tourner des têtes. »
Ces contes sont souvent des scènes de théâtre érotique, avec leur trio classique : mari nigaud, femme rusée, amant agile. Mais loin de diaboliser les femmes, le poète en fait les héroïnes actives du récit, qui cherchent, trouvent, goûtent et prennent, toujours avec esprit, et parfois avec audace.
L’Église en prend pour son grade
Impossible de parler de La Fontaine libertin sans évoquer son goût pour le blasphème tendre. Le clergé est souvent la cible privilégiée de ses moqueries. Confesseurs lubriques, moines un peu trop entreprenants, nonnes aux cuisses agiles, tout le monde passe à la casserole.
Dans Le Diable de Papefiguière, un moine prétend que les fesses d’une jeune fille sont hantées par un démon… et s’improvise exorciste avec une ferveur bien peu théologique. L’humour est potache, mais l’intention est mordante. Il s’agit de dénoncer l’hypocrisie religieuse, tout en s’amusant des désirs humains qui débordent toujours les dogmes.
« Il dit des prières, puis mit la main
Sur ce bel endroit qu’on nomme vilain. »
Ces contes sont donc plus qu’un divertissement. Ils sont une critique sociale, un pied de nez à l’autorité et une manière de dire que les corps, même saints, ne résistent pas au désir.
Ni pornographie, ni pudeur
La Fontaine n’écrit pas du sexe pour faire bander (même si parfois, ça fonctionne très bien). Il écrit le désir dans ce qu’il a de comique, de poétique et de vital. Il rit des postures, mais célèbre les pulsions. Il moque les naïfs, mais honore les audacieux.
« Un vit joyeux est un dieu généreux. »
Il ne s’agit pas d’excitation brute, mais d’un plaisir lettré, d’un érotisme élégant, parfois cru et jamais vulgaire. L’alexandrin devient caresse, la métaphore se fait clin d’œil. Le sexe, ici, est toujours un jeu de langage, de ruse, de masque et de mise en scène.
À ce titre, La Fontaine est l’un des grands maîtres de la littérature libertine pré-Lumières, aux côtés de Théophile de Viau, de Sade (en plus tendre), ou de Crébillon fils (en moins sophistiqué).
Une réception contrastée, une œuvre réhabilitée
Ces contes, bien sûr, furent censurés. Leur publication officielle n’est autorisée qu’à partir de 1726, cinquante ans après leur rédaction. Trop risqués, trop libres, trop… féminins, peut-être ? Pourtant, ils circulèrent sous le manteau, copiés, murmurés, lus à voix basse dans les alcôves éclairées aux chandelles.
Aujourd’hui, on les redécouvre comme des chefs-d’œuvre de finesse érotique et de critique sociale. Plusieurs éditions modernes, notamment celle annotée par Jean-Pierre Collinet (Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade), permettent d’en savourer toutes les subtilités.
On dit souvent que la France a inventé l’art d’aimer. Et si c’est vrai, alors La Fontaine en a écrit la grammaire grivoise. Avec ses contes libertins, il nous offre un érotisme où la langue est aussi frémissante que les corps, où le sexe n’est jamais triste, et où les femmes sont moins des muses que des stratèges du plaisir.
« Ce qu’on apprend sous les draps vaut parfois mieux que tout un sermon. »
Comment l’esprit vient aux filles ? En les laissant faire, en les écoutant rire, en écrivant pour elles. C’est peut-être ça, au fond, le génie libertin de La Fontaine : un homme qui a compris que le désir est affaire de jeu, d’égalité… et de vers bien troussés.