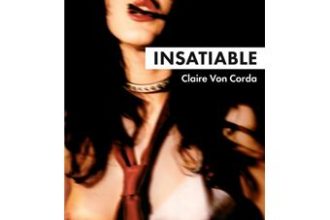James Joyce, Lettres à Nora, obscénité sublime et passion nue
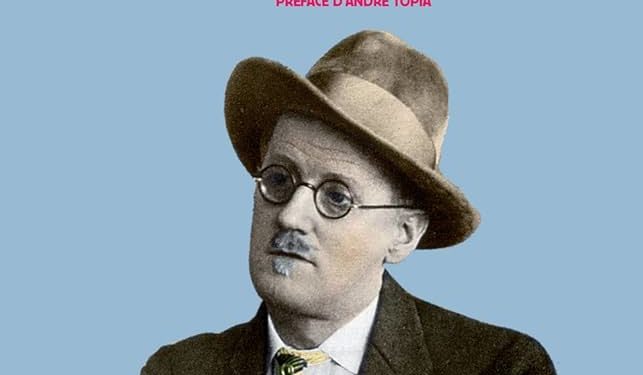
« Ma petite salope d’amour, mon petit oiseau de merde et de lait, tu me manques dans l’odeur. » Lettre à Nora, 16 décembre 1909
Certaines correspondances s’égrènent en soupirs contenus, en formules polies ou en amours convenables. D’autres, plus rares, jaillissent sans pudeur, s’étalent, s’égouttent et halètent jusqu’à transformer la lettre en corps vivant. À lire les Lettres à Nora de James Joyce, l’impression est immédiate : ici, l’amour n’est pas un sentiment, c’est une sécrétion. Entre 1904 et 1909, Joyce, encore jeune écrivain mais déjà tout entier dévoré par l’écriture, adresse à Nora Barnacle, sa compagne, des lettres d’amour d’un érotisme inouï, d’un lyrisme obscène et d’une crudité tendre. Le futur auteur d’Ulysse y parle de fesses ouvertes, de pets adorés, de culottes mouillées et dans ce débordement d’obsession, quelque chose de rare surgit : l’invention d’une langue du désir. Ces missives ne sont pas seulement obscènes. Elles sont tendres, inquiétantes et parfois, drôles. Mais toujours, elles battent d’une urgence : écrire Nora pour la sentir vivante, l’absorber par l’encre et jouir de ses absences autant que de ses présences. Loin d’une posture, Lettres à Nora révèle un écrivain à nu, vibratile, animal, amoureux jusqu’à l’extase et jusqu’à la honte. Chronique d’un monologue intérieur qui s’épanche dans le slip humide de ses propres mots.
Nora, l’aimée, la salope et la muse
Ce qui bouleverse dans Lettres à Nora, au-delà de l’ardeur sexuelle, c’est la place absolue de Nora dans l’imaginaire joycien. Elle n’est pas une simple destinataire. Elle est une souveraine à laquelle il se livre, corps et âme, sans détour ni fierté. Tout commence en 1904, à Dublin. Nora Barnacle est serveuse dans un hôtel, elle a des yeux clairs et un tempérament aussi libre que celui de Joyce est exalté. Il l’aborde, l’entraîne et l’aime. Elle devient sa compagne de toute une vie, la mère de ses enfants, la première lectrice et la dernière présence. Mais dans ces lettres, elle est autre chose. Elle est l’objet du désir, la bête aimée la salope adorée et la petite chatte absente.
« Tu ne peux pas imaginer, mon amour, à quel point ton cul me manque. Je rêve de ton odeur. Je rêve de ton pet. »
C’est frontal voir inconfortable, parfois. Mais il y a une vérité absolue dans cette parole-là. Joyce n’idéalise pas Nora. Il la veut, avec son corps : sa saleté, sa douceur, son silence, sa chatte humide, ses règles et ses pets. Il invente un amour qui ne sépare jamais le sublime du trivial. Par-delà la trivialité assumée, ce que l’auteur célèbre, c’est la totalité du corps vivant, et à travers lui, une féminité libre, pleine et indomptée. Il ne veut pas d’une muse idéalisée. Il aime son amante dans sa sueur, ses menstrues et ses effluves. À rebours des fantasmes convenus, il épouse le réel jusque dans ses bruits et ses humeurs.
Nora devient la matrice de Molly Bloom (la femme du personnage principal Leopold Bloom dans Ulysse), la source du monologue et la voix chaude au creux de toutes ses phrases. Sans elle, l’écrivain n’écrirait pas comme il écrit et elle est sa langue autant que son fantasme. Et dans cette tension entre le désir brut et la dévotion amoureuse, se niche un érotisme sans équivalent. Cette vénération sans filtre bouscule les codes de l’érotisme bourgeois. Nora n’est pas aseptisée, blanchie par l’amour : elle est odeur, son et texture. C’est cette radicalité qui donne à leur lien une puissance inédite : Joyce écrit à la chair comme d’autres écrivent à Dieu. Sans sacrilège, sans ornement et dans une prosternation organique.
L’obscénité comme forme d’amour absolue
Ce qui rend ces lettres aussi puissantes, ce n’est pas seulement leur contenu, c’est leur forme. L’homme y écrit comme il respire ou comme il baise. Les phrases dérapent, les mots se répètent et la syntaxe devient rythme corporel. C’est brut, mais c’est aussi extrêmement construit. L’amoureux transis n’écrit pas mal, il écrit hors des marges. Et dans ce désordre apparent, il trouve une musique sexuelle, une pulsation de texte qui est déjà la promesse de ce qu’il fera plus tard dans Ulysse.
« Mon amour mon amour mon amour mon cul ton cul ton pet ta chatte. Je bande j’écris je jouis. »
Les lettres sont crues, très crues. L’homme de lettres y écrit ce que très peu d’hommes osent écrire à leurs amantes : pas seulement l’envie du corps, mais l’odeur, la sueur, la fente, l’anus, les poils, le sang, le pet. Et pourtant, jamais il ne s’agit de dégrader. Toujours, il s’agit d’adorer.
« J’ai envie de m’enfoncer dans toi jusqu’à ne plus sentir où je commence. De t’ouvrir, de t’emplir, de t’épuiser. »
Mais la vulgarité, chez Joyce, n’est jamais gratuite. Elle est langue de la possession. Lui qui écrivait dans le silence glacé de la censure irlandaise, entre deux lettres à son éditeur et mille refus de publication, écrivait à Nora ce que le monde ne devait pas entendre : le désir d’un homme qui aime trop, mal et tout. Il ne cherche pas à séduire mais à être dans, à posséder, à sentir et à revivre par les mots ce que la distance lui interdit. Et dans cette absence, la lettre devient du sexe.
« Je t’écris comme je te pénètre. Lente, longue, forte. Je veux que chaque mot te laisse une marque. »
Ce n’est pas de la littérature érotique, c’est une écriture du manque. Une façon de survivre à l’absence en déposant dans l’encre tout le fluide que l’on ne peut pas verser ailleurs.
Le désir comme langage
On sent que ces lettres sont aussi un laboratoire de style. Il y expérimente ce qu’il n’a pas encore le droit d’imprimer : le flux de conscience, la répétition et la langue comme orgasme. Et cette écriture qui sue, qui mouille, nous prend à revers. On est troublé, on rit, on frissonne, on est gêné, mais surtout, on est touché. Parce que Joyce n’écrit pas pour le scandale. Il écrit pour toucher au sens propre, sale et sublime. Au fond, ces missives témoignent de quelque chose de plus vaste encore : l’érotisme est une modalité de l’écriture et réciproquement : écrire, pour lui, c’est bander, suer et haleter. Il n’y a pas de distance entre le mot et le corps. Chaque phrase est un spasme et un souffle. Chaque image naît d’une tension et d’une friction. Il écrit à sa muse comme il la lèche, la mord et l’enlace. Il fait de la syntaxe un espace de pénétration. Dans cette fusion rare entre littérature et sexualité, l’écrivain précède de plusieurs décennies les grandes explorations modernes du corps textuel. Mais lui le fait sans manifeste et sans posture. Il baise avec les mots parce qu’il n’a pas d’autre choix.
Et ce qui pourrait apparaître comme une simple curiosité licencieuse devient, sous la plume de Joyce, un art de l’incarnation littéraire. Lire ces lettres aujourd’hui reste une expérience troublante. L’obscénité est telle qu’elle ferait rougir bien des libertins modernes. Mais est-elle gratuite ? Loin de là. Chaque mot scabreux et chaque image crue est un geste de dépossession. L’auteur ne fait pas l’étalage d’une puissance sexuelle, il expose sa vulnérabilité et son besoin. Derrière les évocations de pets ou de fesses aplaties, il y a une prière : « ne m’oublie pas » et « désire-moi encore ».
« Quand tu lâches ton pet doucement entre mes bras ou en me tenant la main, mon amour pour toi grandit à n’en plus pouvoir. » Lettre du 9 décembre 1909
Ce n’est pas la vulgarité qui choque, c’est la transparence du désir, nue, honteuse parfois, mais profondément sincère. Joyce refuse l’élégance sociale, il réclame l’intime, même sordide, comme la seule preuve tangible de l’amour. Et le génie est là : dans cette manière d’aller chercher le sublime sous la crasse et la beauté dans la sueur.
Finalement, Lettres à Nora n’est pas une correspondance érotique ordinaire. C’est un champ de bataille sensuel où se mêlent la solitude, la passion, la peur et la jubilation. Un espace où les mots s’essayent à capturer l’instant vivant, l’odeur d’un corps et la chaleur d’un pet amoureux. James Joyce n’a pas seulement écrit des lettres à Nora : il a écrit au sexe, à la sueur, à l’absence et à la dépendance. Il a donné forme littéraire à l’urgence amoureuse la plus crue et la plus vibrante. Il a su transformer l’obscène en offrande, la trivialité en chant et la fange en prière. Et dans ces lettres, aussi inclassables que nécessaires, l’amour n’a jamais été aussi peu convenable. Ni aussi vivant.