Maurice Leblanc, Nouvelles Sensuelles, le désir en contrebande
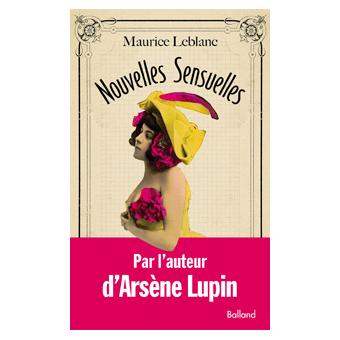
« Elle n’avait rien dit. Mais tout en elle suggérait l’accord, ce léger basculement du corps vers l’attente. »
On croyait connaître Maurice Leblanc avec l’élégance feutrée d’Arsène Lupin, ses énigmes raffinées, ses intrigues ciselées comme des serrures forcées et son intelligence joyeuse au service du crime. Et pourtant, sous ses allures de conteur mondain, l’homme cachait sous sa plume d’auteur à mystères un tout autre talent : celui d’écrire le trouble à fleur de peau, avec une finesse quasi chirurgicale. Dans ses Nouvelles Sensuelles, l’auteur troque la canne du gentleman cambrioleur pour une plume douce, tendue, sensuelle et infiniment retenue. On y découvre un écrivain du frôlement, du soupir avant l’étreinte et du désir qui rôde plus qu’il ne bondit. Publié dans la discrétion, ce recueil rassemble des histoires d’apparence anodine, presque triviales : une épouse lasse, un jeune homme curieux, un regard échangé ou un frisson dissimulé derrière le rideau des convenances. Mais sous la surface, le feu. Quand le père de Lupin glisse la main sous la soie, l’amour n’est pas un cri. C’est un murmure entre deux pages. Et Leblanc, loin des coups de théâtre, se fait le chroniqueur doux-amer des caresses différées. Chronique d’une œuvre qui chauffe lentement la pulpe des mots, s’attarde sur les gestes plus que sur les corps, ose l’érotisme du silence, du pli dans la robe et du rire qu’on étouffe après avoir frôlé l’interdit.
Quand le désir se joue à huis clos
Chaque nouvelle est un petit théâtre, une scène de genre, feutrée et délicatement piégée. Rien de spectaculaire, mais des moments suspendus et des amours qu’on effleure plus qu’on ne consomme. On y croise des épouses trop lisses, des maris distraits, des inconnus aux manières exquises, des amis de la famille, des amants maladroits, et toujours, le désir qui pousse comme une fleur dans une fissure.
« Elle baissa les yeux, comme si le silence entre eux avait soudain le goût d’un baiser volé. »
Ce n’est pas un érotisme de grand soir. C’est un érotisme de salon, de palier ou d’alcôve. Le désir s’installe sans bruit dans un intérieur bourgeois, sur une terrasse d’un café à la tombée du jour ou dans un compartiment de train. On n’arrache rien, on ne déchire pas : on frôle, on esquive, on joue. Et toujours, quelque chose glisse. Une frontière morale s’efface, un non-dit prend la parole et le désir discret, poli, mais furieux s’invite dans la pièce.
« Elle portait une robe d’été, simple, mais l’échancrure du décolleté semblait poser une question qu’aucun mot n’aurait osé formuler. »
Maurice Leblanc ne cherche pas l’explosion. Il préfère l’érosion délicieuse, celle qui commence par un regard qui s’attarde, un mot qui tremble ou un geste qu’on interprète à demi. Le sexe est rarement nommé, mais plutôt deviné, murmuré et insinué. Sous sa plume, le manque devient plaisir, les non-dits des actes et l’hésitation une caresse.
C’est l’érotisme du clair-obscur, de la porcelaine fissurée et du fauteuil trop bas qui invite à se pencher. Un art de la suggestion si maîtrisé qu’il en devient presque plus sensuel que les scènes explicites. Ses personnages ne sont pas de grands libertins mais des gens ordinaires, traversés par des élans qui les dérangent autant qu’ils les éveillent. Ses récits imagent les tensions domestiques du désir, les dérèglements doux et les glissements imprévus.
Dans la nouvelle La Chemise, une femme laisse tomber un bouton en feignant l’accident. Dans L’Heure du thé, une servante sert sans parler, mais ses gestes sont si précis, si silencieusement provocants, qu’on croit entendre les pensées de son maître monter comme la vapeur du thé. Un simple regard devient presque obscène et une lettre oubliée brûle plus que mille étreintes. Leblanc décrit le moment juste avant le toucher et la transgression, là où le fantasme est encore pur.
Une langue sèche, tenue, et pourtant brûlante
Ce qui frappe dans ces nouvelles, c’est la retenue de la langue. Pas d’excès, d’emphase ou de lyrisme ampoulé, mais une élégance sèche, précise et tendue. L’auteur écrit avec une distance qui trouble. Il ne donne jamais dans la grandiloquence sensuelle, et pourtant, chaque mot semble vibrer d’un frisson intérieur. C’est une prose de velours glacé qui, à force de contenir l’élan, le rend encore plus perceptible.
« Il l’observa, sans cligner des yeux, comme on observe une mèche allumée qui se rapproche d’une étincelle. »
Ce n’est pas un érotisme de la métaphore mais de l’intelligence. Tout est dans l’ellipse, les nuances et ce qui n’est pas dit. Les dialogues, souvent menus, disent plus par ce qu’ils taisent. Les gestes sont décrits avec une netteté quasi clinique, mais jamais froide. C’est l’écriture d’un homme qui regarde sans jamais s’imposer. Ici, la sensualité passe par le style et la précision plus que par la passion. On est loin des descriptions alanguies ou des effusions rabelaisiennes. C’est l’art du dosage, dans cette tension exquise entre le plaisir et le protocole.
« Elle riait, mais son rire sonnait comme un verre trop plein qu’on pose avec précaution. »
Cette pudeur, paradoxalement, devient puissance. Elle laisse au lecteur l’espace du fantasme. On entre dans ces textes comme dans une chambre inconnue où chaque rideau cache peut-être un lit défait. Dans L’Accord parfait, deux musiciens jouent ensemble pour la première fois. Leurs doigts s’approchent sans se frôler et leurs regards se croisent au rythme des mesures. Le morceau s’achève mais la tension ne retombe pas. Rien ne se passe et pourtant, tout est là. Et le plaisir n’est jamais là où on l’attend. Il naît d’un mot déplacé, d’un bouton qui résiste ou d’un silence trop long. Et quand enfin la peau se touche, c’est comme si l’on entendait le tissu tomber.
Sous la bienséance, le trouble
On sent, dans ces nouvelles, un monde d’étiquette qui craque doucement. Les bonnes manières se fissurent et les convenances dérapent, mais toujours avec ce voile de respectabilité qui rend les déviations plus délicieuses.
Maurice Leblanc écrit comme un voyeur bien élevé. Il n’expose pas mais suggère. Il n’arrache pas les corsets, il les déboutonne lentement. Et dans cette retenue, il capte une vérité du désir rarement dite : celle qui ne cherche pas le scandale, mais le vertige léger, le déplacement intérieur et la chaleur qui monte sans prévenir.
« Elle avait ce genre de sourire qu’on devine avoir été murmuré avant d’être offert. »
On n’est jamais dans l’extase brutale, mais plutôt dans le trouble prolongé, celui qui reste après la lecture, comme une odeur dans les draps. Et parfois, une phrase suffit à tout chavirer, comme une main qu’on poserait par mégarde.
Dans ses récits, les personnages féminins sont saisissants. Ni héroïnes ni soumises, elles sont curieuses, souveraines, parfois joueuses, parfois complices. Elles ne tombent pas dans les bras d’un homme par faiblesse, mais par goût. Elles choisissent, décident ou alors, manipulent avec grâce. Leur sensualité n’est jamais naïve, mais stratégique et incarnée. Une robe ouverte sur la cheville, un mouvement de chevelure réajustée, une voix qui baisse et c’est un monde qui chancelle.
« Elle savait exactement ce que sa présence faisait à cette pièce. Et elle s’y tenait comme une actrice sûre de sa lumière. »
Les hommes, eux, sont souvent dépassés. Submergés par ce qu’ils ressentent sans pouvoir l’exprimer. Ils observent, tentent, reculent, s’excusent et persistent. Ce sont des figures flottantes, plus rêveuses qu’entreprenantes, souvent pris dans leur propre trouble. Et c’est là que Leblanc devient subtil : le pouvoir n’est jamais net. Il circule, glisse et passe de l’un à l’autre sans s’annoncer. Il n’y a pas de dominants ou de dominés. Il y a des regards, des accords tacites et des failles où le désir s’insinue.
Dans Le Souvenir d’un baiser, un homme marié croise par hasard une ancienne amante. Rien ne se dit. Mais la manière dont elle ajuste son gant, la façon dont il écarte à peine son manteau… Tout ressurgit. Et ce qui n’a pas été vécu brûle plus fort que ce qui a été consommé.
Finalement l’inventeur du cambrioleur mondain a une main qui caresse au lieu de crocheter et qui suggère au lieu de voler. Les Nouvelles Sensuelles ne cherchent pas à rivaliser avec Sade ou Esparbec. Elles n’en ont ni la cruauté ni la crudité. C’est une œuvre discrète, modeste mais redoutablement sensuelle. Cette littérature du frisson ose le détail du regard qui insiste et le frémissement de la main qui s’attarde sur une tasse un peu trop longtemps. Maurice Leblanc y déploie une sensualité bourgeoise et délicieusement piégée. Un érotisme de l’entre-deux, du presque ou du pas encore. Et dans un monde littéraire qui s’égare parfois dans le cri ou la crudité, ces nouvelles offrent un contrepoint d’une rare élégance : celui du désir tenu, du trouble poli et du sexe en gant de velours.
« Ce qu’il aimait en elle, c’était cette pudeur parfaitement jouée, comme un corset qu’on sait devoir enlever — mais pas trop vite. »
Et c’est peut-être là qu’il est le plus fort : dans sa manière d’écrire le désir comme une énigme à deviner, et non un secret éventré. On referme le recueil avec cette sensation rare, celle d’avoir été regardé lentement, finement et sans jamais savoir si l’on devait baisser les yeux ou sourire en retour.
« Ce n’est pas le corps qu’il déshabille, c’est la pensée. Et c’est pire. »


