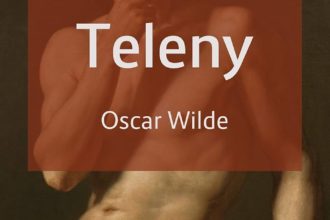La Pharmacienne d’Esparbec, une jouissance sous ordonnance
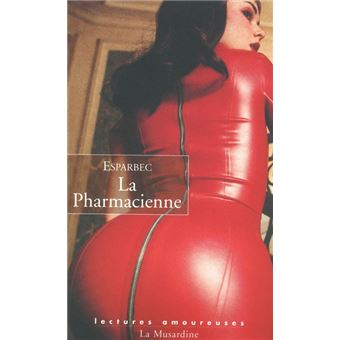
« Elle était de ces femmes qu’on aurait voulu lire dans le noir, à voix basse, les lèvres humides, sans jamais tourner la dernière page. »
Dans la rue des Pensées-Troublantes, se cache une pharmacie discrète, à l’ancienne, où l’odeur de camphre se mêle à quelque chose de plus chaud et de plus charnel. Derrière son comptoir, une femme à la beauté calme et au sourire imperceptiblement moqueur, sert les clients de ses gestes assurés. Elle connaît les posologies, les contre-indications, les secrets d’alcôve et les fêlures du désir. Elle vend des sirops, des pilules, des capotes, mais délivre surtout, un trouble bien plus persistant. C’est elle, La Pharmacienne d’Esparbec, qui règne sur son officine comme une dompteuse de pulsion. Cette héroïne glacée, maîtresse du dosage et prêtresse de l’excès tempéré, est une figure de fantasme au flegme torride, autour de qui se joue une partition explicitement assumée : celle du sexe à l’état brut, prescrit sans ordonnance, administré sans détour et raconté avec la précision d’un écrivain maniaque de la jouissance. Plongée dans un univers de corps, de langage et d’étrange justesse qui rend le fantasme presque… plausible.
Esparbec, le pornographe lettré
Avant d’ouvrir le flacon, il faut lire l’étiquette. Esparbec, c’est un pseudonyme, mais c’est aussi une institution. L’homme, né en 1932 sous un nom bien plus discret, écrit des dizaines de romans érotiques, publiés notamment chez La Musardine, dont il est une plume phare. Sa plume crue est prolifique demeure l’une des plus assumée de la scène porno littéraire française. Avec La Pharmacienne, publié en 1999, l’auteur mystérieux livre ce que beaucoup considèrent comme son chef-d’œuvre. Le roman de plus de 300 pages est traversé de scènes sexuelles d’une intensité constante, de dialogues à la Audiard version sexe et d’un regard d’entomologiste sur les fantasmes masculins.
Mais lire Esparbec au premier degré serait une erreur. Sous la saturation d’éjaculations et de soumissions, il y a une langue. Cette langue, parfois vulgaire et souvent répétitive, est une manière d’écrire le plaisir comme on creuse un tunnel : à la main, en sueur et avec obstination.
Une intrigue lubrifiée
Le narrateur, Pierre Lombard, jeune chômeur au talent verbal certain mais à l’ambition flottante, pousse la porte d’une officine de quartier pour y déposer un CV. Il y rencontre une pharmacienne aux allures de veuve érotique et d’institutrice sadique. Elle l’embauche, bien sûr, et le convoque bientôt, au sous-sol, pour des tâches plus… viscérales.
Commence alors un enchaînement de scènes sexuelles aussi méthodiques qu’improbables. Chaque jour est un nouveau traitement, parfois seul avec la pharmacienne, parfois accompagné de patientes, d’amies, de voisines ou de collégiennes majeures. Et toutes sont décrites avec une régularité clinique.
« Elle me saisit par les hanches et me guida vers elle comme on introduit un suppositoire récalcitrant. »
La trame est simple, le décor réduit et le temps aboli. Tout converge vers le sexe, encore, toujours, et surtout sans la moindre pause émotionnelle. Le désir est ici mécanisé, industrialisé et ritualisé. Et c’est dans cette saturation même que le roman devient singulier. On ne lit pas Esparbec pour le suspense mais pour le vertige que son écriture procure.
Un système sexuel
On pourrait croire que La Pharmacienne n’est qu’une succession de scènes hard, un alignement méthodique de positions et de fluides, une encyclopédie du foutre en format poche. Mais ce serait oublier la précision du dispositif. Rien n’est laissé au hasard. Chaque scène est une variation sur un thème obsessionnel : fellation, sodomie, double pénétration, urophilie, exhibition… Tout est là. Trop là, peut-être. Jusqu’à saturation. Car l’auteur ne cherche pas tant à exciter qu’à épuiser le fantasme. Il le pousse dans ses retranchements, le mène jusqu’à ce point de bascule où le désir devient presque absurde et où l’excitation frôle la stupeur.
« Elle voulait tout, tout de suite. Et je n’étais qu’un distributeur automatique de foutre. »
Ici, les corps sont réduits à leurs fonctions, des systèmes de fluides et de frottements. Le désir se fait mécanique : pénétrer, jouir et recommencer. C’est une lubrification perpétuelle, sans pause et sans pudeur. Et pourtant, ça fonctionne, mieux, ça fascine. Pourquoi ? Parce qu’Esparbec écrit trop bien pour ce qu’il raconte. Et c’est précisément là que tout se joue. Il maîtrise l’art du rythme, la phrase courte et le tempo syncopé des scènes qui s’enchaînent comme des battements trop rapides. La chute, toujours un peu trop crue pour être tout à fait sérieuse, éclaire le texte d’un second degré trouble. Il y a du style, beaucoup de style. Trop de style, parfois, pour un univers qui feint l’absence totale d’âme. On lit, on grimace, on sourit et l’on devine, derrière la sueur des scènes, un écrivain qui se cache dans le sexe comme derrière un paravent et qui, par moments, se laisse trahir par son intelligence.
La pharmacienne, une douce figure de domination
Au centre du roman, elle, sans prénom, juste la pharmacienne. Elle n’est ni hystérique ou dominatrice de pacotille, mais calme et froidement déterminée. Elle prend, choisit, décide et organise les séances comme d’autres préparent une perfusion : avec méthode, précision et sans états d’âme. Elle dirige les partages et les humiliations d’un regard, d’une injonction calme ou d’un soupir.
« Elle avait cette autorité douce des femmes qui savent exactement combien de fois elles jouiront. »
Elle ne crie jamais, ne réclame rien mais administre. Et dans cette posture de contrôle, froide et troublante, elle devient une figure hybride : à la fois fantasme pur et centre névralgique du désir. Cet objet rêvé des hommes et sujet absolu de la scène incarne une forme de pouvoir sexuel rare, où le féminin règne sans élever la voix. La pharmacienne n’a nul besoin d’effet. Sa présence, son rythme et sa science du dosage suffisent.
Mais ne nous y trompons pas, le récit n’est pas un roman féministe. Il est profondément masculin, parfois même outrageusement machiste dans ses dynamiques, ses dialogues et ses pénétrations en série. Pourtant, dans cet excès, quelque chose dérape. À force d’excès, la toute-puissance virile finit par se fissurer. Ce qui devait imposer se dilue. L’obsession devient mécanique, puis fatigue. Car on ne bande pas impunément pendant 300 pages. Même dans la fiction, le corps flanche, le fantasme s’use, et quelque chose d’humain revient par la fente. Et c’est peut-être là, dans ce flottement involontaire, que le roman devient intéressant : quand la jouissance programmée commence à clignoter. Le sexe cesse d’être spectaculaire pour redevenir un effort, un vertige et une faille.
Une lecture faite de malaise, de lucidité et d’excitation
Comment lire ce texte aujourd’hui ? Avec des pincettes, curiosité ou une forme de gêne, peut-être ? Sans doute avec tout cela à la fois. Comme beaucoup de textes signés Esparbec, le roman ne franchit pas sans heurts les filtres de la représentation contemporaine : pas de consentement formulé, des femmes ultra-sexualisées et un imaginaire patriarcal tout droit sorti d’un fantasme en gants de cuir. Et pourtant, le lire, c’est aussi lire une époque, un genre et une esthétique. C’est une pornographie littéraire assumée pour ce qu’elle est : une construction excessive, démesurée et parfois fascinante dans son entêtement à ne rien lisser.
« À force de la prendre, je ne savais plus si c’était elle qui me possédait. »
Esparbec a cette capacité étrange à ne jamais s’excuser de ce qu’il écrit. Il ne cherche ni à choquer ni à plaire. Il ne drape pas ses scènes de sexe de considérations philosophiques sur le désir ou la domination. Il écrit la pornographie comme un artisan : méthodique, régulier et presque obsessionnel. Il visse les fantasmes un à un, avec la régularité d’un ouvrier du trouble. Et c’est peut-être là, dans cette honnêteté brute, que surgit un effet secondaire inattendu : une forme de lucidité, presque involontaire, sur le désir masculin. Un désir qui s’épuise à force de vouloir tout, qui tourne en boucle, qui cherche l’excès pour oublier le manque et qui finit par avouer, entre deux éjaculations littéraires, qu’il ne sait plus très bien ce qu’il cherche. Le sexe n’est pas une célébration, mais une compulsion, un vertige et un aveu.
La Pharmacienne n’est pas un roman à glisser entre toutes les mains. Il heurte, lasse, exagère et déborde. Il pousse le fantasme jusqu’à l’usure, jusqu’à cette limite où le désir devient mécanique et presque absurde. Mais son roman dit quelque chose. Il parle de jouissance masculine, de son acharnement et de son insondable solitude. L’obsession tourne en boucle, le regard posé, voire imposé, sur le corps féminin. Il parle de ce que l’on fantasme, ce que l’on tait et de ce qu’on écrit à défaut de pouvoir vivre. Et dans son genre, le plus cru, le plus frontal, La Pharmacienne est une œuvre fondatrice. À lire comme on lit certains poèmes obscènes du Moyen Âge : non pour s’émoustiller, mais pour comprendre ce que le sexe fait au langage et ce que le langage ose faire au sexe.
« J’ai compris qu’on pouvait jouir sans amour. Mais aussi, qu’on pouvait écrire sans honte. »
Il ne s’agit pas de valider, ni de condamner, mais d’écouter ce que le texte trahit malgré lui. Dans les scènes les plus saturées, il y a parfois une fatigue, une faille et une forme d’humanité qui surnage sous les fluides.